Les registres médicaux occupent une fonction essentielle dans la médecine contemporaine, et ce sera encore plus le cas ces prochaines années avec le développement de la médecine personnalisée, du Big data et de la cybersanté. En collectant, organisant et analysant des données de santé sur des populations spécifiques, ils jouent un rôle central dans la recherche épidémiologique. Et fournissent des informations précieuses pour optimiser la prise en charge des patient-e-s.
«Les registres donnent accès à des données probantes sur les résultats des traitements et peuvent guider nos décisions thérapeutiques, détaille la PD Dre Alix Stern, médecin-cheffe du département d’oncologie du RHNe. Les prises en charge évoluent, et il est probable que les futurs médecins exerceront leur métier différemment de nous, en s’appuyant aussi sur un savoir numérique solide.»
«Les registres médicaux sont essentiels pour formuler des hypothèses, analyser l’efficacité des traitements en conditions réelles et valider des biomarqueurs ou des signatures génomiques.»
PD Dre Alix Stern
La Fédération des médecins suisses (FMH) recense actuellement 117 registres dans le pays. Certains sont obligatoires, comme le Registre fédéral des donneurs d’organes vivants ou les Registres cantonaux des cancers. La participation à d’autres est requise pour remplir des mandats spécifiques, notamment en médecine hautement spécialisée, ou pour obtenir une certification. C’est le cas du Registre suisse des accidents vasculaires cérébraux (AVC), obligatoire pour être un centre reconnu de prise en charge, comme l’est le RHNe qui suit en moyenne 450 victimes d’AVC par an. Enfin, des registres sont «gérés, sur une base volontaire, par des sociétés professionnelles, des hôpitaux, des universités, des fondations ou d’autres organisations du système de santé», rappelle l’Académie suisse des sciences médicales. Leur tenue permet par exemple de constituer un savoir de référence sur des techniques très spécialisées, comme la pose de pacemakers ou d’implants orthopédiques.
Grâce aux véritables trésors d’informations que sont devenus les registres médicaux, non seulement les traitements, en oncologie comme ailleurs, deviennent de plus en plus précis et personnalisés, augmentant les chances de survie, mais les diagnostics peuvent aussi être affinés et l’évolution des maladies surveillées. En identifiant des similarités entre des cas uniques, ils s’avèrent également indispensables pour mieux cerner et traiter les maladies rares ou orphelines.

PD Dre Alix Stern, médecin-cheffe du département d’oncologie du RHNe
Créé en 2013, le Registre suisse des maladies rares illustre cette utilité. Les recueils de data ont par ailleurs un rôle clé dans le suivi des pratiques médicales, les contrôles de qualité et la recherche médicale grâce à la masse de données qu’ils fournissent. «Dans la recherche, ils sont essentiels pour formuler des hypothèses, analyser l’efficacité des traitements en conditions réelles et valider des biomarqueurs ou des signatures génomiques (ndlr: l’empreinte génétique qui permet d’identifier les caractéristiques d’une maladie)», énumère l’oncologue-hématologue.
Depuis décembre 2023, l’introduction du consentement général au RHNe permet aux patient-e-s de donner leur accord pour l’utilisation de leurs données et échantillons biologiques à des fins de recherche dans le cadre de la Loi sur la recherche sur les personnes (LRH). Bien que les registres, recueillant des données anonymes et souvent imposés par des obligations légales, ne soient pas directement concernés par la LRH, le consentement général appuie la recherche en élargissant considérablement les bases de données disponibles.
«L’investissement en temps et en argent est assez modeste par rapport à la valeur que dégagent les registres.» Baptiste Gauthier, coordinateur de la recherche clinique au RHNe
«En 2024, environ 15 000 personnes auront été sollicitées pour donner leur consentement dans notre institution, précise Baptiste Gauthier, docteur en neurosciences cognitives et coordinateur de la recherche clinique au RHNe. Même si seulement la moitié d’entre elles répondait positivement, cela ajouterait des milliers de données supplémentaires pour nos recherches.»
Contrairement aux études cliniques, limitées dans le temps et ciblées, les registres collectent des informations complètes et continues sur une large population: «Leur grande force, c’est d’avoir énormément de points de données», souligne Baptiste Gauthier. Lorsqu’elle respecte des standards internationaux, cette data peut être combinée entre pays, créant des bases de données gigantesques et extrêmement détaillées. «Mais cette standardisation et l’interopérabilité restent des défis majeurs, rappelle Alix Stern. Ces éléments sont cruciaux pour exploiter pleinement leur potentiel.»
L’oncologie, pionnière dans la collecte de données
Les registres médicaux ont émergé dans les pays du Nord dès le XIXe siècle, puis se sont répandus dans le monde au XXe siècle, portés par les avancées technologiques et l’informatique. En Suisse, l’oncologie a été un domaine pionnier dans leur mise en place. Le premier registre des tumeurs a vu le jour à Bâle en 1969, suivi de Genève en 1970, puis de Vaud et Neuchâtel en 1974, rappelle l’Organe national d’enregistrement du cancer (ONEC). Cependant, c’est seulement depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) en 2020 que les cantons ont l’obligation de tenir un registre des cancers ou de s’affilier à un registre existant.
En vertu de l’article 24 de la LEMO, la Confédération peut aussi accorder des aides financières à des registres consacrés à d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement graves, renforçant ainsi l’impact de ces outils pour la santé publique.
Aujourd’hui, la Suisse dispose ainsi de treize Registres cantonaux des tumeurs, ainsi que d’un Registre fédéral du cancer de l’enfant. «L’inscription obligatoire montre une volonté fédérale forte de structurer le savoir et de surveiller de manière très fine les cancers», se réjouit Baptiste Gauthier. Les patient-e-s oncologiques ont toutefois un droit d’opposition à l’inscription de leur données dans ces registres.
Ces collectes systématiques d’informations contribuent à l’amélioration constante de la prise en charge: «L’initiative internationale The Cancer Genome Atlas Program, lancée en 2005, est par exemple un programme fascinant générant, entre autres, des données génomiques et protéomiques (ndlr: informations issues de l’analyse complète de l’ADN d’un individu et informations sur les protéines produites par son organisme) sur des échantillons de cancer, détaille la Dre Alix Stern. Elles ont déjà permis de mieux diagnostiquer, classer et traiter certaines formes de cancer. Dans le futur, cet héritage en biologie «numérique» deviendra de plus en plus relevant en nous aidant à prendre des décisions thérapeutiques de manière très personnalisée.»
Vers une médecine plus équitable
Conserver les données, oui, mais surtout les organiser: telle est la mission principale des registres. «Le mot-clé pour comprendre leur intérêt, c’est la stratification, c’est-à-dire la définition des catégories de patients selon des critères cliniques», explique le coordinateur de recherche clinique au RHNe.
Pour le registre des cancers, ces critères peuvent concerner la morphologie de la tumeur ou des métastases, mais aussi la génétique. «Par exemple, le gène HER 2, exprimé dans certains cancers du sein, permet de prédire plus ou moins bien la réponse à certains traiements, indique Baptiste Gauthier. Plus les données sont riches et précises, plus on peut affiner des catégories sur la réponse au traitement et adapter les prises en charge, ce qui améliore considérablement le pronostic.»
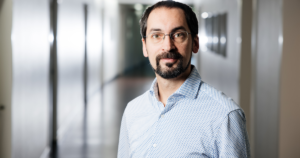
Baptiste Gauthier coordinateur de la recherche clinique au RHNe. Photo: Guillaume Perret
Outre les données objectives, les données subjectives ont également leur place: «Cette notion de vécu s’intègre aux registres parce que les effets secondaires, la qualité de vie et la sensibilité du patient entrent en ligne de compte quand les médecins doivent faire des propositions de traitements.»
Médecin-assistante en oncologie, la Dre Oana-Maria Toncean porte un intérêt marqué pour l’onco-dermatologie. L’enregistrement obligatoire des nouveaux diagnostics de tumeur n’a pas fondamentalement changé sa pratique, qui repose principalement sur les guidelines, la discussion avec les cadres superviseurs et les collègues d’autres disciplines impliqués dans la prise en charge des patient-e-s.
Pour les cas complexes, l’échange avec d’autres centres est très utile, comme elle a pu en faire l’expérience en présentant le cas d’un patient lors de la première Journée romande de dermato-oncologie. Cet événement a réuni en octobre 2024 plus de 100 participant-e-s pour échanger sur la prise en charge des mélanomes et autres tumeurs cutanées avec des expert-e-s de renommée internationale.
Parallèlement, les registres médicaux, en recueillant systématiquement des informations sur une population plus large, contribuent à rendre – enfin – la médecine plus universelle et représentative des divers facteurs tels que l’âge, le genre ou l’origine. «Il était temps qu’on s’empare enfin de ce sujet, s’exclame Baptiste Gauthier. Avec ces grandes bases de données, on voit clairement que certaines propriétés métaboliques varient selon l’âge, l’origine géographique ou ethnique et impactent l’efficacité des médicaments. De même, des différences liées au sexe, longtemps négligées dans les essais cliniques, deviennent plus évidentes. On parvient à stratifier davantage les populations et à apporter du sens à une hétérogénéité que la médecine a longtemps eu du mal à prendre en compte. Ce qui permet d’adapter les soins de manière plus précise et équitable.»
La prévention pour maîtriser les coûts
Essentiels pour la recherche et la personnalisation des traitements, les registres médicaux se heurtent toutefois à un défi majeur: ils nécessitent des ressources humaines et financières importantes. L’intelligence artificielle peut cependant en optimiser l’efficacité: «Elle est capable de trouver des stratifications que l’humain ne peut pas repérer dans des milliers de données, note le coordinateur de recherche. Cela accélérera le développement des registres en augmentant la qualité de l’utilisation des données et favorisera la création de démarches nationales et internationales pour les regrouper. Car l’important n’est pas d’amasser des données, mais de les acquérir avec des critères permettant de les mettre en relation.»
Bien que la personnalisation des traitements qui découle de l’usage des registres augmente également les coûts de la santé, le bénéfice s’annonce conséquent, selon l’expert: «L’investissement en temps et en argent est assez modeste par rapport à la valeur que dégagent les registres.» Ils constituent en effet aussi des outils précieux pour identifier des vulnérabilités spécifiques et améliorer la prévention, un levier crucial pour réduire les coûts.
«Ils permettent une meilleure planification en terme de politique de santé en identifiant, par exemple, des facteurs de risque pour le développement d’un cancer comme les habitudes de vie, les déterminants sociaux, biologiques et même environnementaux, remarque la Dre Alix Stern. Cela peut orienter les campagnes de dépistage précoce ou les programmes de vaccination, comme ceux contre le HPV pour prévenir le cancer du col de l’utérus, ou encore inciter à des initiatives de promotion de la santé.» Et d’ajouter qu’un bel exemple est la reconnaissance qu’une mauvaise alimentation et la sédentarité peuvent accroître le risque d’apparition de certaines formes de cancer: «Des initiatives comme la stratégie cantonale neuchâteloise, qui fait de l’alimentation équilibrée et de l’activité physique une priorité, illustrent cet impact. Cette stratégie, validée par le Conseil d’État, répond à la nécessité de contrecarrer les risques en mettant en œuvre des mesures ciblées dès la petite enfance. Manger sainement et bouger s’apprend plus facilement durant l’enfance et prévenir un cancer est toujours préférable que d’en guérir.»
«Quel équilibre coût-confort-survie notre société sera-t-elle prête à accepter? Ce sont des questions difficiles et beaucoup ne s’y intéressent que lorsque cela les touche directement» Baptiste Gauthier, coordinateur de la recherche clinique au RHNe
Le revers de la médaille
Malgré l’espoir généré par les registres, ils comportent aussi des risques notables: «La personnalisation de la médecine précise les pronostics. Or, avoir un pronostic précis, c’est courir le risque que l’information soit utilisée à mauvais escient par un système d’assurance ou un système politique, soupire Baptiste Gauthier. Cette précision nous oblige aussi à nous questionner: est-il pertinent que la population finance des soins extrêmement lourds, quand on sait d’avance que les pronostics sont mauvais ? Quel équilibre coût-confort-survie notre société sera-t-elle prête à accepter ? Ce sont des questions difficiles et beaucoup ne s’y intéressent que lorsque cela les touche directement. Malheureusement, il faudra se les poser de plus en plus.»
Le deuxième grand danger réside dans le risque d’identification des personnes en raison de la richesse des éléments collectés: «Les données sont bien anonymisées, mais plus elles sont nombreuses et détaillées, plus il devient facile d’identifier les individus en les croisant. Ce problème n’est pas propre aux données médicales, c’est une loi des données, ce n’est la faute de personne. Mais évidemment, quand il s’agit d’informations médicales, c’est beaucoup plus sensible.» Une préoccupation que partage la Dre Alix Stern pour qui la protection des données des patient-e-s doit rester la priorité. «Il est nécessaire d’adopter une mise à niveau technologique, car la collecte ne cessera d’augmenter et le risque grandira avec elle», conclut le coordinateur.
Les biobanques, piliers du traitement contre le mélanome
Le chirurgien viscéral Alend Saadi, également spécialiste du mélanome, détaille l’impact des registres de tissus dans l’évolution des soins de ce cancer de la peau.
Médecin-chef du service de chirurgie et directeur du Centre de l’obésité du RHNe, le Dr Alend Saadi est également au bénéfice d’une formation du traitement chirurgical du mélanome. un cancer auquel il a consacré une partie de son activité, lorsqu’il exerçait au CHUV il y a une dizaine d’années, avant que l’immunothérapie ne révolutionne la prise en charge de ce cancer, fatal dans un cas sur trois et résistant à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

Dr Alend Saadi, Médecin-chef du service de chirurgie et directeur du centre de l’obésité du RHNe. © Guillaume Perret
RHNe MAG: Comment les registres ont-ils permis d’améliorer les traitements contre le mélanome ?
Dr Alend Saadi: Les patients atteints de mélanome qui ont accepté de fournir des échantillons de tissus ont permis à des chercheurs de nombreuses institutions de travailler sur l’immunité autour de ces cancers. Ces échantillons, conservés dans des biobanques, c’est-à-dire des registres de tissus, ont facilité l’identification des différentes réponses immunitaires et le développement de l’immunothérapie pour renforcer ces mécanismes de défense naturelle contre le cancer. Il s’agissait d’une avancée cruciale, car les chimiothérapies sont peu efficaces contre le mélanome. Alors que la chirurgie était autrefois presque la seule option, l’immunothérapie est désormais utilisée en complément chirurgical ou en cas de risque élevé de récidive.
Combien de temps ces tissus se conservent-ils?
Les biobanques offrent un avantage majeur: elles permettent de revisiter des échantillons des années après leur collecte, à la lumière des avancées scientifiques. Elles sont comme des archives vivantes de données biologiques: si de nouveaux marqueurs du mélanome ou de nouvelles techniques sont découverts, ces échantillons serviront pour de nouvelles recherches, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes.
Dans quelle mesure les registres cantonaux des tumeurs contribuent-ils à un traitement du mélanome plus personnalisé ?
Ils jouent aussi un rôle-clé dans l’évolution vers des traitements de plus en plus ciblés, notamment en immunothérapie, qui fait déjà partie des thérapies personnalisées. Actuellement, on fonctionne encore par catégories: on donne l’immunothérapie à tel ou tel profil de cancers. Mais à l’avenir, on ira plus loin en créant des sous-groupes encore plus précis ou même en traitant le cancer particulier de telle ou telle personne. Ces sous-groupes reposent surtout sur les caractéristiques spécifiques des cancers, mais le genre, l’âge ou l’origine peuvent être pris en compte.
Quels registres utilisez-vous en chirurgie?
Nous en utilisons plusieurs, notamment ceux obligatoires pour la médecine hautement spécialisée. Par exemple, la chirurgie bariatrique pratiquée au Centre de l’obésité du RHNe exige une participation à un registre, axé sur le contrôle de qualité. On y consigne le déroulement des interventions et les suites postopératoires précoces. Un autre registre important, SwissNoso, recense les infections postopératoires. Il nous permet de comparer nos résultats avec d’autres hôpitaux suisses, d’évaluer la qualité des soins et d’identifier les points à améliorer, ce qui contribue à une meilleure prise en charge.
La Suisse est-elle en avance dans ce domaine?
Pas vraiment. Nous avons des registres et des biobanques importants et précieux, mais dans des pays comme la Suède, la Norvège ou les Pays-Bas, c’est bien plus développé. Ils ont des registres nationaux pour presque tout, ce qui leur permet de dégager des tendances majeures pour les recherches cliniques. Lors de congrès ou de réunions spécialisées, les médecins de ces pays partagent leurs données et tendances, ce qui peut nous inspirer pour améliorer nos pratiques. Cependant, chaque pays a ses spécificités locales, donc avoir des bases de données nationales bien structurées en Suisse serait un atout énorme.
Qu’est-ce qui freine ce développement?
En Suisse, la santé est cantonale, ce qui complique la coordination des registres. De plus, ils nécessitent des ressources financières et organisationnelles importantes. Il s’agit d’un investissement conséquent, oui, mais les résultats sont extrêmement bénéfiques pour la population dans son ensemble. Une étude du Boston Consulting Group appelée «Improving Health Care value» en 2011, à propos de treize registres dans cinq pays, a montré qu’ils peuvent améliorer les soins tout en diminuant les coûts globaux de la santé. Pour que les registres soient efficaces, il faut des données de qualité, mais aussi une très grande quantité pour repérer également les tendances rares ou de faible intensité.
Par exemple?
Un effet secondaire rare, mais potentiellement grave, peut passer inaperçu dans une étude clinique même sérieuse et bien menée portant sur quelques centaines de patients. Avec les registres, qui incluent des milliers de cas, ces effets peuvent être identifiés et analysés, améliorant ainsi la sécurité des traitements.
Quel impact les registres ont-ils sur votre travail quotidien?
Dans notre programme pluridisciplinaire ERAs (Enhanced Recovery After surgery), dédié à l’amélioration des soins postopératoires notamment en chirurgie du côlon, le registre nous permet de suivre en continu nos pratiques réelles et non pas supposées. C’est un feedback précieux, car on peut observer sa propre évolution et se comparer à d’autres centres, d’autres pays. Ces données améliorent la vision de notre travail et, donc, la qualité des soins. C’est l’exemple type de l’amélioration des soins et qui, en conséquence, diminue les coûts malgré l’investissement consenti au départ et pour l’entretenir. Car améliorer les soins aboutit très souvent à baisser les coûts.
Travaillez-vous sur des projets liés aux registres?
Depuis plus de 10 ans, nous participons au registre de contrôle de qualité pour le suivi postopératoire en chirurgie bariatrique, qui couvre la période péri-opératoire. un registre à long terme nous permettrait d’obtenir davantage d’informations pour mener des études cliniques et affiner en conséquence nos pratiques au bénéfice des patients. Nous travaillons actuellement à sa mise en place au RHNe.




