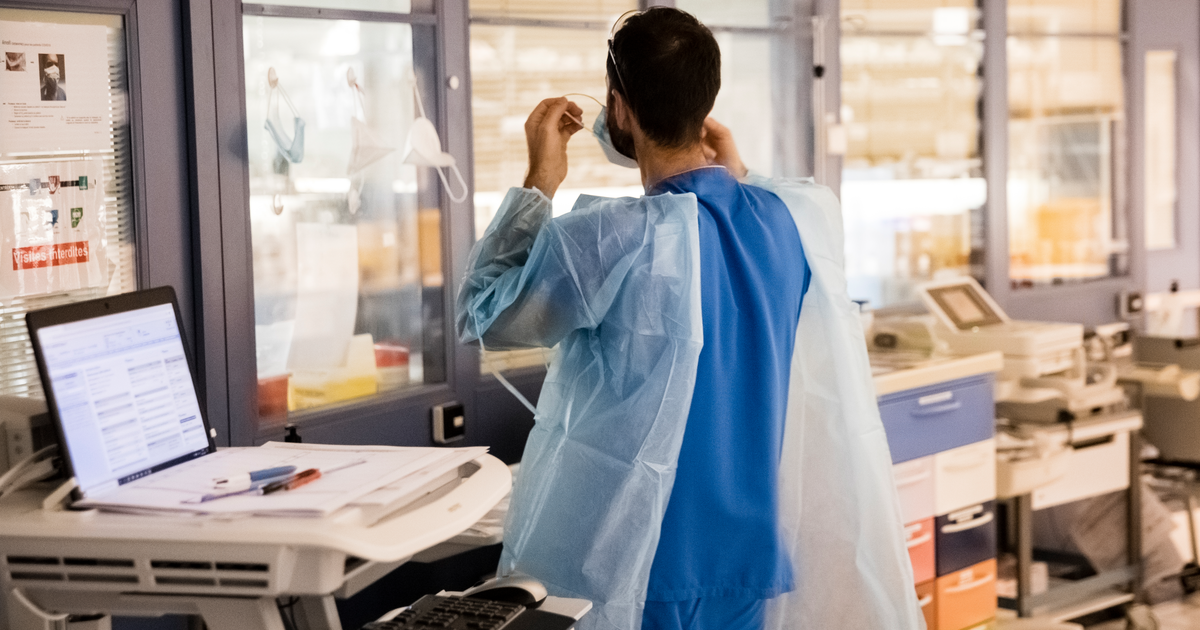SANTÉ PUBLIQUE – Les germes multirésistants sont devenus un enjeu mondial et un défi pour le service d’infectiologie du RHNe, qui relève que nous pouvons tou-te-s contribuer à préserver l’efficacité des antibiotiques.
La résistance aux antibiotiques est l’une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé mondiale et la sécurité alimentaire, prévient l’Organisation mondiale de la santé. N’importe qui peut être touché à n’importe quel âge. C’en est au point que des infections que l’on soignait aisément redeviennent parfois fatales.
Cette problématique constitue un défi pour notre société et les hôpitaux en particulier. Au Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), c’est une préoccupation quotidienne. Voici les explications de la Dre Andréa Künzli, médecin-cheffe adjointe du service d’infectiologie, et Pierre Vanderavero, infirmier responsable de l’unité de prévention et contrôle de l’infection (UPCI). Cette unité travaille à prévenir la transmission des agents infectieux au sein de l’hôpital, dont les germes résistants aux antibiotiques.
Pourquoi l’antibiorésistance s’est-elle accentuée au fil du temps?
Dre A. Künzli: C’est un phénomène naturel qui a été amplifié en raison de la surutilisation d’antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire – à savoir qu’en Suisse, environ 80% des antibiotiques administrés sont prescrits à des animaux. Lorsque l’on recourt à des antibiotiques, des bactéries résistantes apparaissent, elles trouvent des parades. En conséquence, toujours plus de germes ne répondent plus aux traitements. Ces bactéries circulent dans l’environnement et se transmettent. Cela peut arriver entre les animaux de production et les êtres humains, par le biais de l’alimentation ou par des contacts avec une personne colonisée.
20% : C’est le taux de résistance des E. coli, souvent à l’origine d’infections rénales, contre une classe d’antibiotiques fréquemment utilisée
Est-ce qu’on arrive à chiffrer le phénomène?
A.K.: Les autorités suisses opèrent une surveillance du taux des bactéries multirésistantes par le biais d’une déclaration obligatoire de résultats de prélèvements cliniques chez l’humain et d’échantillonnages dans les abattoirs, entre autres. D’une bactérie à l’autre, les tendances varient: par exemple, la présence du staphylocoque doré MRSA était plus élevée il y a quelques années en Suisse. Pourtant, cette bactérie multirésistante continue d’être transmise dans la population. En revanche, d’autres bactéries connaissent une évolution inquiétante, à l’instar d’Escherichia coli, fréquemment à l’origine des infections urinaires: des souches résistantes de ce pathogène très commun sont toujours plus répandues. Aujourd’hui, le taux de résistance de l’E. Coli contre une classe d’antibiotiques fréquemment utilisée pour le traitement des pyélonéphrites, les fluoroquinolones, est de 20%. Ce taux a doublé ces vingt dernières années.
Un problème aggravé par le tourisme et les voyages…
A.K.: Absolument, car les personnes qui reviennent de l’étranger ramènent souvent, à leur insu, des bactéries réfractaires aux antibiotiques. La présence de souches multirésistantes varie beaucoup d’un pays à l’autre. La Suisse est davantage concernée que les pays scandinaves, mais moins que l’Italie ou la France. Ailleurs dans le monde, le problème peut être plus lancinant. En séjournant en Inde, par exemple, le voyageur a un grand risque d’être colonisé par des bactéries multirésistantes. Cette colonisation persiste longtemps: la moitié des patients seront encore porteurs après une année. C’est pourquoi une surveillance systématique est appliquée dans les hôpitaux: tout patient qui a été médicalement pris en charge à l’étranger – quel que soit le pays – est dépisté dès son admission. S’il s’avère qu’il est porteur d’une bactérie résistante, il est placé en isolement afin de limiter la propagation de cette souche.
Pierre Vanderavero: Le tourisme médical constitue aussi une source fréquente de colonisations voire d’infections à des germes multirésistants, à l’instar des actes de médecine esthétique réalisés dans des pays où les règles d’hygiène hospitalière ne sont pas aussi bien respectées qu’en Suisse. Encore ce matin, une de nos patientes a dû être opérée pour retirer des implants mammaires posés dans un pays d’Afrique du Nord, parce qu’ils étaient infectés par des germes multirésistants et donc difficiles à traiter.
«Lorsque l’on recourt à des antibiotiques, des bactéries résistantes apparaissent, elles trouvent des parades», Dre Andréa Künzli
Quelles sont vos stratégies de lutte contre l’antibiorésistance?
A. K. : Nous veillons à ce que les antibiotiques soient utilisés à bon escient dans les services hospitaliers. Le rôle d’un infectiologue consiste à conseiller nos collègues des autres spécialités sur l’indication, le choix et la durée d’une antibiothérapie, en utilisant le spectre le plus étroit possible. La formation des jeunes médecins à une utilisation adéquate des antibiotiques est un point crucial également.
P. V. : Il y a toujours un risque de transmission par l’intermédiaire du personnel et du matériel médical. C’est pourquoi les trois infirmiers et infirmières de l’UPCI interviennent sur les sites du RHNe pour promouvoir les mesures de prévention. Depuis 2011, l’hygiène des mains fait l’objet d’un programme spécifique qui nous a valu un prix en 2017. Notre rôle est aussi de coordonner la mise en œuvre de mesures strictes quand certains germes sont détectés sur un patient: après avoir été alertés par le laboratoire, nous informons le service où il séjourne pour expliquer le type d’isolement préconisé. Selon la souche bactérienne en présence, cela implique le port d’une surblouse et une désinfection accrue des lieux.
CONFÉRENCE
«L’antibiorésistance, ça vous concerne?» était le thème de la conférence des Jeudis du RHNe du 21 novembre 2024. Elle peut être visionnée sur ce lien.
Inutile contre des virus
«Pour que la médecine puisse fonctionner, nous avons besoin d’antibiotiques», souligne la Dre Andréa Künzli. «Mais en cas de surutilisation, des résistances surviennent.» Un patient hospitalisé sur deux reçoit un antibiotique en prophylaxie, comme lors d’une pose de prothèse articulaire ou d’une chimiothérapie, ou en traitement. En cas d’infection à une bactérie multirésistante, l’infectiologue doit recourir à un antibiotique de réserve. Le problème est qu’il risque d’être moins bien toléré et qu’il coûte beaucoup plus cher que les formules usuelles. Et malgré tout, près de 300 personnes décèdent chaque année en Suisse à la suite d’une infection par une bactérie multirésistante.
Pas d’antibiotique en automédication!
La Dre Künzli conseille de respecter les durées de traitement, de ne pas oublier de prendre les doses, et surtout de ne jamais prendre un antibiotique en automédication. Autres conseils: se faire vacciner contre la grippe et le Covid si l’on est une personne à risque pour éviter les surinfections qui peuvent en découler, comme celle au pneumocoque par exemple.
Prendre des antibiotiques en cas de maladies causées par des virus est inutile et potentiellement dangereux. Dans la vie quotidienne, l’infirmier responsable de l’UPCI Pierre Vanderavero rappelle l’importance de l’hygiène des mains (avant de cuisiner, de manger, etc.) et de porter le masque ou garder ses distances quand on est enrhumé.
Lire également
Articles